Le temps des vampires : le capitalisme financier contre l’économie réelle
| 1 avril, 2015 | Posté par Ender |
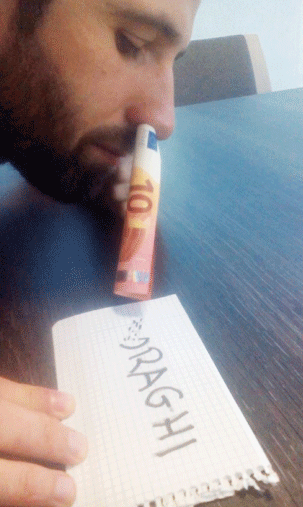
L’économie mondiale est entrée depuis 2008 dans un modèle non conventionnel qui a rendu caduques les analyses traditionnelles, notamment en ce qui concerne les politiques monétaires.
Les programmes de rachat d’obligations souveraines de la part de la banque centrale américaine à partir de 2008, connus sous le nom de Qantitative Easing, et destinés à fournir de la liquidité à un système bancaire paralysé par les créances pourries et le risque de faillite, ont gonflé le bilan de la FED de 800 à 4500 milliards de dollars. En 2008 puis en 2010, la FED a ainsi lancé deux programmes de rachats successifs de bons du trésor pour un montant total de 2300 milliards d’euros. En 2013, Ben Bernanke a décidé le lancement d’un nouveau programme de rachat de titres adossés à des crédits hypothécaires (subprimes), destiné à épurer le système bancaire des créances pourries, pour un montant de 40 milliards de dollars par mois. A ces différents programmes, il faut ajouter également le dispositifs « twist » de rachat d’obligations du trésor à court terme au profit d’obligations à long terme, d’un montant de 400 milliards de dollars, dans le but de faire baisser les taux longs et de relancer le secteur immobilier après le crash de 2008.
En complément de ces différentes mesures d’injections de liquidités et d’apurement des créances pourries du système bancaire, la FED a également mené une politique de baisse des taux destinée à relancer l’activité économique en encourageant le crédit. Entre janvier et décembre 2008, le taux directeur de la FED est ainsi passé de 3,50% à 0,25%, qui reste le taux actuellement en vigueur.
Quel bilan peut-on tirer de la politique de la FED ?
La mise en place du QE en 2008 et sa prolongation en 2010 puis 2013 a été qualifié de politique « non conventionnelle », elle fut assimilée par la plupart des analystes financiers à une politique de création monétaire inédite. Dans le corpus économique néo-classique, représenté notamment par l’école monétariste, la création monétaire à cette échelle devait ainsi théoriquement déclencher un processus inflationniste, voir hyperinflationniste. Les analyses prédisant une hyperinflation similaire à celle que connu l’Allemagne dans les années 30 se sont ainsi multipliées, comme le montre par exemple cet article de Forbes. Cependant, dés 2013, il est devenu évident que l’inflation de la masse monétaire américaine ne se propageait pas dans l’économie réelle, et que les peurs de certaines catégories d’investisseurs, étaient sinon infondées, du moins largement irrationnelles ou basées sur des analyses simplistes, voir sur leur propre intérêt clientéliste dans le cas des « goldbrokers ».
L’inflation est ainsi restée stable, à 1,6% en 2010, 3% en 2011, 2,1% en 2012 et 1,5% en 2013 alors que dans le même temps la masse monétaire triplait pour passer sur la même période approximativement de 1000 à plus de 3000 milliards de dollars. Cette augmentation de plus de 200% de la masse monétaire ne s’est donc pas traduite par la moindre inflation, contredisant la théorie monétaire. Il n’y a qu’une seule explication à ce phénomène : la création monétaire n’a pas atteint l’économie réelle mais est restée cantonnée dans le secteur financier.
Le salaire minimum fédéral a ainsi diminué sur la même période.Les salaires réels sur la période 2009-2013 ont plongé de plus de 4% en moyenne aux états-unis pour 95% des salariés. Les classes moyennes et populaires américaines ont continué à s’appauvrir, comme le montre les statistiques du programme fédéral d’aide alimentaire. 20% des enfants bénéficiaient du programme des bons alimentaires en 2014 contre 12% en 2007, soit un enfant sur cinq. Au total, 46 millions d’américains ont recours au programme d’aide alimentaire aujourd’hui, alors qu’ils étaient moins de 30 millions en 2008.
L’appauvrissement des ménages américains est également visible dans la baisse du taux d’épargne qui signifie que ces derniers ont pioché dans leurs économies afin de maintenir leur niveau de vie ou faire face à leurs dépenses de santé. Ce dernier est passé de 6,1% en 2009 à 5,2 en 2014.
Les statistiques concernant la baisse du taux de chômage sont également en trompe l’oeil et ne reflètent pas la réalité du marché de l’emploi. Depuis un plus haut historique de 9,9 % en 2010, le taux de chômage officiel est tombé à 5,6 % en 2014, ce qui a conduit la plupart des analystes à conclure à une reprise de l’économie américaine. Dans le même temps, le taux d’emploi, c’est à dire le nombre de personnes participant au marché du travail, a chuté pour passer d’un peu plus de 9 % avant la crise à un peu plus de 5 % en 2014, ce qui signifie que les bonnes statistiques du chômage s’expliquent en réalité par le fait que des millions d’américains sont purement et simplement sorti du marché du travail et ont renoncé à chercher un emploi.
Dans le même temps, le marché de l’immobilier, boosté par le programme de rachats d’actifs pourris de la FED en 2013 et la politique de taux zéros, s‘est redressé de 10 % sur l’année 2013 avant de ralentir. L’immobilier de luxe a lui, battu un record de ventes pour l’année 2014.
Pour savoir dans quel secteur se sont investies les liquidités de la FED, il faut également regarder l’évolution des marchés actions sur la période des différents QE.
L’indice boursier Standard and Poors est passé de 800 points en mai 2009 a plus de 2000 points en février 2015, soit une augmentation supérieure à 150% en 6 ans.
L’action de la FED a donc permis essentiellement de fournir le système bancaire en liquidités qui ont été massivement investies sur les marchés financiers. Dans le même temps, la politique de taux zéro destinée à faire baisser les taux longs des obligations souveraines a poussé les investisseurs en quête de rendements à réorienter leurs capitaux vers ces mêmes marchés financiers. Les marchés actions sont donc tirés par une gigantesque intervention de la banque centrale américaine depuis 5 ans, et se retrouvent de fait totalement déconnectés de l’économie réelle. La sphère financière alimentée par la FED évolue aujourd’hui de manière complètement indépendante de la sphère économique, elle impose de plus ses exigences de rendements à cette dernière. On a ainsi vu se développer des politiques entrepreneuriales que l’on peut qualifier là encore de « non-conventionnelles » et qui ont notamment consisté en des rachats d’actions massifs dans le but de faire monter les cours. Selon le journal Les Echos, les entreprises américaines ont ainsi racheté pour 4000 milliards de dollars de leurs propres titres depuis 2005. Rien que pour l’année 2014 elles ont effectué pour 485 milliards de dollars de rachats d’actions. Cette politique se fait évidemment au détriment de l’investissement productif et des salaires et a entraîné une paupérisation massive des salariés. Elle a pour objectif principal de servir de meilleurs rendements à des actionnaires qui sont devenus de plus en plus gourmands et ont pris l’habitude de voir leur capital s’envoler d’année en année.
L’imposition d’un modèle de prédation américano-germanique en Europe
En Europe, les exigences de rendement du capital financier ont également eu des conséquences dramatiques et bien réelles sur l’économie. La zone euro a mis en place des politiques d’austérité généralisées, motivées par le respect du pacte budgétaire européen, mais également par une vision macro-économique inspirée de la « politique de l’offre » néo-classique qui fait de la rentabilité du capital le préliminaire à une reprise de l’investissement et de la croissance. La théorie voudrait que la trop faible rémunération du capital pénalise l’attractivité des entreprises et leurs capacités d’investissement. Ors, on voit bien avec l’exemple états-unien que la hausse de la profitabilité s’effectue précisément au détriment de l’investissement productif, notamment par le biais des rachats de titres. Le principal levier activé dans l’eurozone afin de gonfler les marges et la profitabilité a été l’austérité salariale et la baisse du coût du travail, qui a débouché sur un appauvrissement massif de la population. L’Allemagne, qui a été le pays précurseur de ces politiques au début des années 2000, en est un bon exemple. Les réformes « Hartz » mises en place par le gouvernement de Gerard Schröder ont consisté en une flexibilisation, c’est à dire une précarisation, du marché du travail, ainsi qu’à une baisse des prestations sociales, notamment des allocations chômage. Les licenciements ont été facilités, le travail à temps partiel encouragé, et les « mini-jobs » exonérés de charges sociales. Conséquence, si le chômage a baissé pour passer de 5,3 millions de demandeurs d’emplois en 2005 à 3 millions en 2013, c’est au prix d’une paupérisation massive. Le nombre de travailleurs pauvres (gagnant moins des 2/3 du salaire médian) a explosé et ils représentent aujourd’hui 22 % des salariés.15,5 % de la population allemande vivait sous le seuil de pauvreté en 2013.
Cependant l’austérité salariale et l’appauvrissement de la population ont permis une croissance spectaculaire de la profitabilité des entreprises allemandes. Leur taux de marge est ainsi passé de 39 % en 2003 à presque 45 % en 2009. L’austérité budgétaire et la déflation salariale réalisent donc l’objectif d’une réallocation de la plus-value en faveur du capital.
Sous couvert de la lutte contre le chômage et dans un contexte de dégradation des comptes publics, la crise économique constitue ainsi une opportunité particulièrement favorable à la mise en place de politiques d’austérité salariale et de destruction des systèmes de sécurité sociale, avec comme objectif opérationnel une augmentation de la profitabilité des entreprises au service du capital financier. L’ordo-libéralisme imposé par l’Allemagne à l’ensemble de l’UE tend à généraliser ces politiques aux autres pays de l’eurozone engagés par le pacte de stabilité budgétaire.
La Grèce, contrainte d’appliquer la potion austéritaire allemande en échange des liquidités d’urgence du Fonds Européen de Stabilité Financière, a par exemple connu une chute du salaire minimum de 35 %, mais aussi une baisse des pensions de 10 % conjuguée à un report de l’âge légal de départ à la retraite. L’économie nationale a été en toute logique laminée, et le PIB s’est effondré de 23% entre 2008 et 2013.
Ce modèle engage les pays de l’eurozone les uns après les autres dans des mécanismes de déflation salariale dans le but de renforcer les marges des entreprises et leur attractivité, au profit du secteur financier et des investisseurs. Comme nous l’avons vu précédemment, les politiques de l’offre ne peuvent cependant pas relancer l’activité économique et la croissance dans un contexte récessif et la contraction de la demande interne amplifie les déséquilibres budgétaires. La zone euro est ainsi entrée en déflation à la fin de l’année 2014. Les prix à la consommation ont reculé de 0,2 % en décembre, 0,6 % en janvier 2015, 0,3 % en février et 0,1 % en mars.
Dans ce contexte, la BCE a décidé en janvier dernier de prendre le relais de la FED en mettant en place un programme de rachats d’obligations souveraines de 60 milliards d’euros par mois. Officiellement, cette décision est motivée par la nécessité de lutter contre la déflation qui s’installe dans l’eurozone. Concrètement, comme l’a montré l’exemple de la FED, ce programme n’aura aucun effet sur les prix à la consommation dans le contexte d’austérité budgétaire et de déflation salariale qui sévit en Europe. L’objectif opérationnel de ce programme consiste donc en réalité à injecter des liquidités supplémentaires dans le système bancaire de l’eurozone afin de doper les rendements financiers. En effet, alors que le Standard and Poors gagnait plus de 150 % en 6 ans grâce aux QE américains, le CAC 40 ne progressait « que » de 40 % en passant de 3000 points en janvier 2009 à 4200 points en décembre 2014.
Le premier effet du QE européen, a ainsi été de placer les indices boursiers sur orbite. Depuis l’annonce de la mise en place du programme de rachat d’actifs souverains par la BCE en janvier, le CAC 40 est passé de 4200 à 5000 points fin mars, soit 19 % de hausse en à peine trois mois…
Guillaume Borel – 31 mars 2015 -